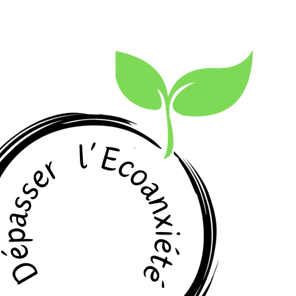La force primordiale de la Terre-Mère
La Femme et la Terre ; métaphores du fond des temps.
FEMMEMYTHESOL
Lambert van Dinteren
1/21/20249 min lire
De la Terre, des femmes et des déesses
Mircea Eliade, spécialiste des religions et mythes, a émis l’hypothèse que les humains ont d'abord eu une sorte d’expérience première, une expérience de ce qui dépasse l’humain. En effet, la terre, ce sol sur lequel il marche, couche, fait l’amour et où il trouve de quoi manger, ce sol dont il voit sortir les plantes qui le nourrissent, c’est comme si c’était de ses entrailles, de l’intérieur de cette couche douce et moite, qu’émerge la vie, tel l’enfant d’une mère. Eliade parle de l’humus comme « couche tellurique et profondeur avec son intarissable capacité de porter fruit » et « Une des premières théophanies de la terre, en tant que telle, en tant notamment que couche tellurique et profondeur chtonienne, a été sa ‘maternité’, son intarissable capacité de porter fruit » [1].
Eliade fait référence à un témoignage amérindien de l’époque moderne :
« Un prophète indien Smohalla, de la tribu Umatilla, interdisait à ses disciples de bêcher la terre, car – disait-il – « C’est un péché de blesser ou de couper, de déchirer ou de gratter notre mère commune par des travaux agricoles (…) Vous me demandez de labourez le sol ? Irai-je prendre un couteau pour le plonger dans le sein de ma mère ? Vous me demandez de bêcher et d’enlever des pierres. Irai-je mutiler ses chairs afin d’arriver jusqu’à ses os ? Vous me demandez de couper l’herbe et le foin et de le vendre, et de m’enrichir comme des Blancs ? Mais comment oserai-je couper la chevelure de ma mère ? » [2].
On retrouve exactement la même révérence pour la terre comme mère vivante dans un texte sacrée de l’Inde.
« Ce que je fends et creuse de toi ô Terre,
Puisse cela même recroître promptement !
Puissé-je n’entamer, ô purifiante,
Ni ton cœur ni quelque point mortel! »[3]
Dans ce sens, mais transposé à une déesse, certains textes sacrées indiens, disent de la déesse Durga que la végétation pousse de son corps.
« Ensuite, ô Dieux ! je nourrirai l’univers entier de ces végétaux
qui entretiennent la vie et qui poussent de mon corps même,
pendant la période des pluies.
Je deviendrai alors glorieuse sur la terre comme
'Porteuse d’herbes' »[4].
Ou encore que la Terre (dans le sens de globe, mais aussi dans le sens de sol) est une mère des plantes, porteuse de toute vie (eaux, plantes, animaux, hommes), giron fécondé pour notre bien.
« La Terre (…) porte les herbes (…) elle possède les eaux
Sur elle s’anime ce qui respire et vibre (…)
La Terre est Mère (…)
Porteuse de toutes choses (…)
C’est toi qui portes les bipèdes, toi les quadrupèdes ;
Tiennes les cinq races d’hommes (…)
Universelle génitrice, Mère des plantes (…)
L’odeur, ô Terre, qui de toi émane,
Celle que portent les plantes et les eaux (…)
Rends-moi parfumé d’elle
Que nul ne nous veuille de mal.
Cette odeur de toi qui a pénétré le lotus (…)
Cette odeur du premier âge, ô Terre :
Rends-moi parfumé d’elle,
Que nul ne nous veuille de mal (…)
Rocher, terreau, pierre ou poussière,
La Terre est ferme et affermie ;
Sa poitrine est faite d’or :
Je rends hommage à la Terre.
Sur elle sont les arbres princes de la forêt ;
Immobiles, ils sont debout toujours.
C’est la Terre toute nourricière,
La Terre solide que nous invoquons. (…)
Que ton giron, libre de mal, libre de fièvre,
Pour notre bien soit fécondé, ô Terre ! (…)
O Terre notre Mère, confère moi la grâce d’un bon établissement »[5].
Julien D'Huy (‘Cosmogonies La Préhistoire des mythes’, Eds. La Découverte, Paris, 2020) et Jean-Loic Le Quellec (‘La caverne originelle - Art, mythes et premières humanités’, Eds. La Découverte, Paris, 2022) ont récemment rendu très possible l'existence, dès la sortie de l’homme anatomiquement moderne de l’Afrique, donc avant environ 60.000 ans avant notre ère, d'un mythe sur l’origine de la vie « émergeant de la terre ». Au commencement, la maîtresse des animaux a fait sortir animaux et humains de ‘sa grotte’.
L’agencement et les peintures de certaines grottes préhistoriques semblent mettre en scène cette sortie primordiale de la grotte – et la lient explicitement à la vulve de la femme. « Dans la partie profonde de la salle du fond de la grotte Chauvet (…) un pendant rocheux est orné d’un triangle pubien rempli de noir et complété d’un sillon vulvaire gravé (…). Ce pendant comporte (…) d’autres traces figuratives : les avant-trains d’un bison (…), d’un félin et d’un mammouth y sont imbriqués tout en paraissant associés – au moins spatialement – à la figure féminine, qui est la plus ancienne. C’est le seul endroit de toute la grotte où ces trois espèces sont agencées de la sorte, et Yanik Le Guillou, qui a étudié ce dispositif, conclut que ces animaux semblent émerger ‘à la fois de la paroi et de la femme/triangle pubien’. (…) situés ‘dans (…) la salle du fond’. Fait remarquable, les animaux situés à leurs entours semblent tous se diriger vers la sortie de la caverne… »[6].
Les rites de nos ancêtres ont très probablement ‘commémoré’, ‘actualisé’ et ‘rendu présente’ cette origine (l'émergence de la grotte primordiale).
Dans certains régions reculées du monde comme l'Est de l'Inde et le Népal, on trouve encore aujourd'hui des sanctuaires de déesses, notamment de Kali, qui se situent ‘au plus profond d’une gorge’, dans le ‘giron de la Terre Mère’. « C’est seulement à la fin de la route qu’une montagne arrondie et à la paroi incurvée, envahie de la plus luxuriante végétation, se laissait voir, formant un lumineux contraste avec le paysage environnant desséché, d’un brun jaunâtre. Bien que ce fût la saison sèche, deux torrents tumultueux dévalaient le long de cette montagne concave, s’écoulant l’un vers l’autre pour former un V et se jeter dans un petit ravin. Non seulement dans la religion de la nature des Khasi, mais dans toute l’Inde, la jonction de deux cours d’eau est considérée comme un lieu sacré, incarnant le giron de la Terre Mère d’où s’écoulent les eaux infinies de la vie » [7].
« Un jour, dit le mythe, des êtres chthoniens se redressèrent donc pour sortir de la grotte originelle, et cet acte fut rappelé et renouvelé, pendant quelques dizaines de milliers d’années, de mille et une façons, par des images rituellement tracées en d’innombrables cavernes… comme elles continuent de l’être aujourd’hui en quelques rares lieux du monde »[8]
Il existe également une autre famille de mythes de l'origine, dites « du plongeon » (plus ancienne que 60.000 ans elle aussi) où la création de la terre est décrite comme une « accumulation » de terre, de sol, suite à la recherche d’une petite poignée de terre au fond de l’eau[9].
« Au commencement, il n’y avait ni soleil, ni lune, ni étoiles. Tout était sombre, et partout il n’y avait que de l’eau. Un radeau survint, flottant sur cette eau. Il venait du nord, et il y avait deux personnes à son bord, Tortue et Père-de-la-Société-secrète. L’eau montait très rapidement. Puis une corde de plumes fut lâchée du ciel, et c’est ainsi que surgit Initiateur-de-la-Terre. Quand il arriva au bout de la corde, il l’attacha à la proue du radeau, et y monta. Son visage était couvert et ne pouvait être vu, mais son corps brillait comme le soleil. Il s’assit et ne dit rien pendant un long moment. Enfin, Tortue lui demanda : « D’où viens-tu ? » ; et Initiateur-de-la-Terre lui répondit « Je viens d’en haut ». Puis Tortue dit : « Frère, ne pourrais-tu pas me faire une bonne terre sèche pour que je puisse parfois sortir de l’eau ? » Initiateur-de-la-Terre répondit « Je ne sais pas. Tu voudrais de la terre ferme, mais comment pourrais-je en créer, si je ne dispose pas de terre pour le faire ? »Tortue répondit : « Si vous m’attachez une pierre autour du bras gauche, je plongerai pour en obtenir » (…) Tortue était partie depuis bien longtemps. Cela faisait six ans qu’elle était partie ; et quand elle remonta, elle était couverte d’une vase verte, tant elle était restée au fond. Lorsqu’elle atteignit la surface, la seule terre qu’elle était parvenue à conserver était incrustée sous ses ongles; le reste avait été emporté par les eaux. De la main droite Initiateur-de-la-Terre prit un couteau en pierre de sous son aisselle gauche et gratta soigneusement la terre encore présente sous les ongles de Tortue. Il mit la terre dans la paume de sa main, et la roula jusqu’à ce qu’elle soit ronde ; elle était aussi grosse qu’un petit caillou. Il la déposa sur la poupe du radeau. Il allait la regarder de temps à autre : elle n’avait pas du tout poussé. La troisième fois qu’il alla regarder, la terre avait assez grandi pour qu’on puisse l’entourer de ses bras. La quatrième fois qu’il regarda, elle était aussi grande que le monde, le radeau était échoué, et tout autour il y avait des montagnes à perte de vue »[10].
Les mythes de création de la terre par des plongeurs sont représentés chez les Amérindiens. Des dieux ou des animaux plongeurs sont envoyés dans les eaux maternelles primitives pour trouver un morceau du corps de la terre à partir duquel le monde va se développer à la surface des eaux. C’est aussi le cas pour de nombreux mythes de création d’Asie centrale. Le créateur Birhor (Inde), par exemple, envoie une série d’animaux dans les profondeurs jusqu’à ce que finalement une insignifiante sangsue plonge et avale un peu de la boue du fond des eaux, qu’elle remonte à la surface et crache dans la main du créateur. De ce minuscule morceau de boue, le créateur forme le monde.
Les mythes de création de l’humanité à partir de terre (boue, poussière, argile) sont trouvés en Chine où la déesse Nügua a modelé la terre jaune pour créer les êtres humains. En Asie centrale, le créateur Altaïque crée des humains à partir d’un morceau de boue qui flottait dans les eaux. Chez les Amérindiens, la déesse Hopi Spider Woman (la Femme-Araignée) a transformé en êtres humains la pensée du créateur en chantant « Puisse la pensée vivre en la modelant en argile ». Le créateur Efe au Congo a fait le premier homme en argile recouvert de peau. Le créateur du peuple malgache a donné vie aux poupées d’argile de sa fille. La déesse Jivaro des Andes a produit un enfant en respirant sur de la terre (…). Quand l’oiseau jaloux, Auhu, a brisé l’enfant en argile, l’enfant et les morceaux brisés sont devenus le monde… Le plus ancien de tous les mythes de création de l’humanité connus est celui des Sumériens de Mésopotamie : leurs dieux ont fait des humains à partir d’argile mais étant ivres quand ils l’ont fait, les pauvres humains sont restés d’une création très imparfaite »[11].
Selon la tradition sémitique et chrétienne le premier homme, l'homme primordial ; est appelé , Adam (de l'hébreu adamah, « terre labourée », « glèbe » ou « sol »), et le dit puisé de la « glèbe » (« poussière ») du sol de la terre :
« IHVH-Adonai Elohims forme le glébeux
– Âdam, poussière de la glèbe – Adama.
Il insuffla en ses narines haleine d vie :
et c’est le glébeux, un être vivant »
(Genèse 2, 7).
Intimement lié à Adam, le glébeux, est la femme « Hava – Vivante », « mère de tout vivant »
« Le glébeux crie le nom de sa femme : Hava – Vivante.
Oui, elle est la mère de tout vivant »
(Genèse 3, 20 – 21).
Et Adam, le glébeux, existe pour « servir la glèbe » et « servir le Jardin » (Genèse 2,5).
« IHVH-Adonaï Elohîms prend le glébeux
et le pose au jardin d’Eden, pour le servir et pour le garder »
(Genèse 2,15)[12
[1]‘Traité d’Histoire des Religions’, Mircea Eliade, Eds. Payot, Paris, 1949 - réédition de 2020 pour les citations, p 254
[2] Comme cité dans Eliade (1949), p 254 (en reprenant un témoignage communiqué par James Mooney, 1896)
[3] Atharva Veda 12, 1
[4] Devi-Mahatmya 92, 43 – 44
[5] Atharva Veda 12, 1 (Veda (1976), p 132-135)
[6] Le Quellec (2022), p 263
[7] 'Les Sociétés matriarcales, Recherches sur les cultures autochtones à travers le monde’, Heide Goettner-Abendroth, Editions des femmes, Paris, 2019 - le Chapitre 'Les Newar' de la vallée de Katmandou’
[9] D’Huy (2020), p 111 – 134
[10] Mythe maidu (Californie centrale) comme cité dans D’Huy (2020), p 109 – 110
[11] ‘Le sol et sa genèse dans la Genèse’ (Bible), C. Feller et L. Feller, dans Étude et Gestion des Sols, Volume 30, 2023 - pages 323 à 331, disponible sur : EGS_2023_30_Feller_323-332.pdf (afes.fr)
12] Traduction d'André Chouraquie

Contact
pr.lambert@yahoo.fr
Socials / Réseaux sociaux
Faites-moi savoir si vous êtes intéressé par le livre à venir (je vous contacterai le moment venu pour vous donner des nouvelles)
Rendez-vous sur la page souscription. Cliquez sur le bouton ci-dessous:
© Lambertus K.M. van Dinteren